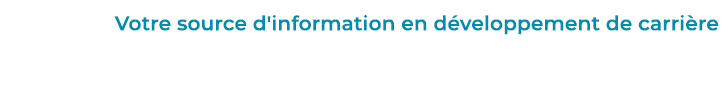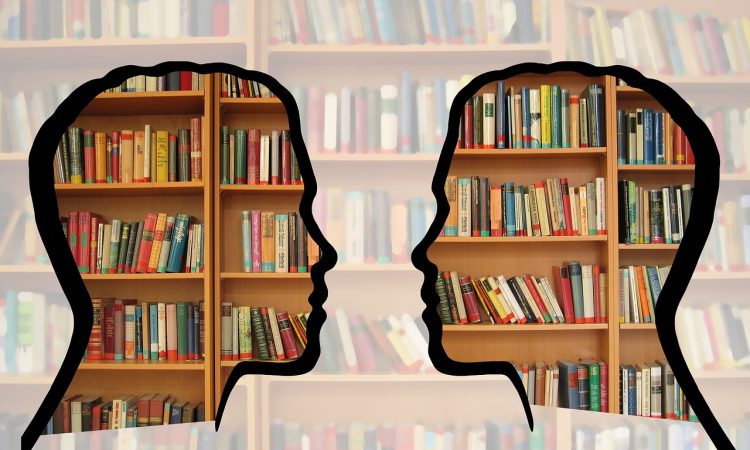|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
L’être humain aime savoir. Si on nous donne le choix entre « ne pas savoir » et « savoir », clairement nous allons préférer la deuxième option. Nous avons donc tendance à rechercher cette posture, celle de la personne qui sait, qui détient la connaissance, rapidement et, idéalement, sans trop d’effort. On vise le but, plutôt que la destination. La ligne d’arrivée, plutôt que les kilomètres à parcourir.
Si on transpose cette image dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les études ou le travail, par exemple, on peut constater que bien des personnes seront inconfortables dans la posture de « ne pas savoir » et voudront, soit se dépêcher à atteindre la posture de « savoir » ou vont se décourager et abandonner. Et pourtant…et pourtant l’espace entre les deux positions, ce qu’on peut appeler « l’espace d’apprentissage », qui peut être plus ou moins long selon les cas, est ce qui nous permet de savoir que nous sommes en train d’apprendre quelque chose, justement. Cet espace est aussi, souvent, synonyme de frustration, car il nous confronte – sur de plus ou moins longues périodes – à des moments de découragement, au sentiment d’incompétence, à la peur de l’échec, etc. Tous des éléments que nous n’aimons pas côtoyer trop souvent. Surtout si une grande part de notre identité repose sur notre réussite scolaire (les notes, par exemple) ou sur notre sentiment de compétence au travail. Si notre sentiment d’être une « personne intelligente » est directement liée à la posture de « vouloir savoir ou savoir », dans ces cas-là, le fait de se retrouver, même temporairement, dans un espace qui vient activer le sentiment de ne pas comprendre et ultimement, d’échec ou d’imposteur, peut être suffisant pour nous faire vivre de la souffrance.
On l’observe, notamment chez des jeunes qui ont toujours eu de la facilité à l’école, toujours eu de bonnes notes sans trop avoir à travailler et qui, au passage du primaire au secondaire ou du secondaire au cégep, sont confrontés soudainement à des situations d’apprentissages difficiles auxquelles rien ne les a préparés. Leur faisant vivre du même coup la désagréable impression de ne plus être intelligent, de ne plus être capable. De même, au travail, des gens qui se réorientent pour une deuxième carrière ou qui sont promus, par exemple, et qui se retrouvent confrontés de nouveau au fait d’être dans cet espace de « ne pas savoir », qui compensent en travaillant de longues heures, sans réaliser que ce n’est pas uniquement ce qui va leur permettre d’atteindre la posture de « savoir » (ou un sentiment de compétence).
Les études démontrent d’ailleurs que l’un des éléments prédicteurs de résilience et de réussite est la capacité de tolérance de la personne face à la frustration que fait vivre cet espace d’apprentissage. Autrement dit, puisque apprentissage = frustration, il y a fort à parier que plus une personne est en mesure de faire face et de naviguer longtemps dans les eaux troubles et houleuses caractéristiques de l’apprentissage, plus on pourra prédire qu’elle arrivera, éventuellement, au rivage des acquis et du savoir.
En sachant qu’une fois ce rivage atteint, un autre espace d’apprentissage risque de s’ouvrir, car dans les faits on ne cesse jamais d’apprendre.
C’est pourquoi, aussi frustrant et décourageant que cela puisse être (voire long et laborieux), le fait de se retrouver dans cet endroit inconfortable est la preuve que nous sommes en train de travailler à générer un éventuel savoir. Que nous sommes en apprentissage. Que quelque chose est en train de se passer. Qu’il y a un principe actif.
À l’époque du consommé-jeté, de la performance à tout prix, de la célébrité rapide, du « swipe », de la richesse à atteindre sans sacrifice, cela peut sembler un contre-courant que de ramener à l’avant-plan le goût et la valeur de l’effort, de l’espace d’apprentissage, du « 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage ».
C’est ce qui fait que le bébé, éventuellement, se met à marcher, bien que ce soit difficile pour lui et que l’espace d’apprentissage – entre ne pas marcher et marcher – soit jalonné de chutes, d’essais et d’erreurs. Heureusement que le bébé n’a pas les mots pour qualifier ses ressentis, qu’il n’a pas le regard critique que nous posons, nous les adultes, sur nos performances et nos avancées. C’est ce qui lui permet de se relever et de réessayer, jusqu’à ce qu’il y arrive.
Alors qu’est-ce que la résilience? Au niveau psychologique, le dictionnaire nous dit que c’est l’aptitude d’un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des difficultés. De la même façon, l’espace d’apprentissage nous invite à plonger dans la frustration, à la trouver utile et même belle, à cultiver notre résilience face aux difficultés parsemées sur nos parcours d’études ou professionnels, à accepter que le chemin tortueux de l’apprentissage comporte autant de beaux et moins beaux moments que la destination finale.
Note : La tolérance à la frustration, également appelée « capacité à gérer la frustration » est l’aptitude d’un individu à supporter un délai ou une déception sans perdre son calme et à agir de manière rationnelle. En d’autres termes, c’est la capacité à accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite et à gérer les émotions négatives qui en découlent.
* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre.
Références
https://performance-tpe.fr/la-tolerance-a-la-frustration-dans-lenfance/
https://performance-tpe.fr/la-faible-tolerance-a-la-frustration-causes-consequences-et-strategies/