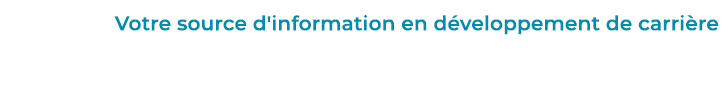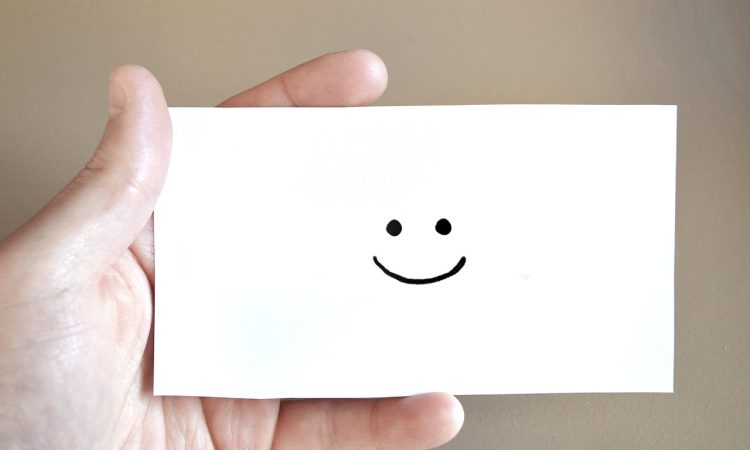|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Le besoin de reconnaissance est universel et est étroitement lié aux besoins d’estime de soi et d’appartenance de la pyramide de Maslow. Il renvoie au désir d’être accepté et d’être valorisé aux yeux des autres.
Être reconnu, c’est « naître dans le regard de l’autre » (reconnaissance).
C’est ressentir que l’on occupe une place légitime au sein d’une communauté, d’un groupe ou d’une équipe de travail.
Le manque de reconnaissance : facteur majeur de risque psychosocial
Seigrist (1996) propose un modèle de compréhension de la reconnaissance au travail fondé sur la notion d’équilibre. Un employé qui ne recevrait pas les avantages légitimes auxquels il croit être en droit d’attendre, compte tenu des efforts déployés, vivrait un manque de reconnaissance. D’autres auteurs, comme Karasek, associent ce manque à une combinaison de facteurs tels qu’une forte exigence psychologique au travail jumelée à une faible autonomie décisionnelle ou à un soutien insuffisant des collègues ou du supérieur hiérarchique.
Le manque de reconnaissance est reconnu comme un facteur de risque psychosocial majeur en milieu de travail. Il peut provoquer un sentiment d’injustice, une baisse de l’estime de soi, une démotivation ainsi que des remises en question quant à ses compétences et à sa place dans l’équipe et l’organisation. Ce processus peut mener à un désengagement progressif de l’employé insatisfait et à une baisse de performance; si le manque de reconnaissance persiste, il peut conduire à une démission. Dans certains cas, l’employé est contraint de demeurer en poste, mais s’expose à un risque accru d’épuisement professionnel.
La reconnaissance au travail : vers un changement de paradigme
La perspective comportementale
Encore aujourd’hui, le concept de reconnaissance au travail tend souvent à être réduit à une simple question de performance. En effet, dans de nombreux environnements de travail, les pratiques de reconnaissance reposent principalement sur une perspective comportementale. Ainsi, les employés capables de bien se conformer aux exigences de leur milieu professionnel se voient récompensés au moment de l’évaluation de rendement annuelle par une augmentation salariale pour l’atteinte des objectifs fixés. Si cette approche peut stimuler une saine compétition, elle comporte néanmoins des effets pervers, dont le risque d’épuisement professionnel en alimentant chez les travailleurs une pression implicite à en faire toujours plus et à s’adapter excessivement aux attentes managériales, au détriment de leur bien-être. Cette suradaptation est même parfois « récompensée » par l’attribution de responsabilités supplémentaires, augmentant la charge de travail et le risque d’épuisement.
La perspective existentielle-humaniste
Cette approche propose une conception plus élargie de la reconnaissance, centrée sur le potentiel de la personne, plutôt que sur sa seule capacité à exécuter des tâches ou à atteindre des objectifs quantifiables.
Ainsi, l’employeur sera davantage enclin à provoquer des rencontres d’équipes, consulter ses employés en plus de les faire participer activement aux processus décisionnels.
La perspective éthique
La perspective éthique met de l’avant les principes de justice et d’équité se reflétant notamment dans la mise en place de pratiques et politiques organisationnelles visant un traitement impartial des employés. Dans cette optique, les travailleurs bénéficient d’un accès équitable à l’information (justice informationnelle), sont traités avec respect et sans favoritisme (justice interpersonnelle), et reçoivent une rémunération équitable et proportionnelle à leurs compétences et responsabilités (justice distributive). La perception d’un employé d’être traité de manière juste et équitable étant un vecteur reconnu de motivation intrinsèque au travail (Fall, 2014).
La perspective psychodynamique
La perspective psychodynamique mise sur la reconnaissance de l’effort et l’engagement personnel au travail indépendamment des résultats obtenus. Elle accorde une attention particulière à l’expérience vécue par les employés dans leur travail, en reconnaissant leur participation même lorsque les objectifs ne sont pas atteints. Se limiter à la reconnaissance des résultats s’avère insuffisant selon cette approche, dans la mesure où leur atteinte dépend de nombreux facteurs échappant parfois au contrôle de l’individu (retards de fournisseurs, départs imprévus d’employés, difficultés économiques, conditions de travail exigeantes, environnement organisationnel instable, etc.).
La reconnaissance : un pilier de la santé organisationnelle
La reconnaissance au travail exerce une influence positive sur la performance des employés ainsi que sur leur engagement affectif envers l’organisation (Dubuc, 2014). Elle constitue également un levier de sens et de motivation, en plus de renforcer le sentiment d’appartenance. Le roulement de personnel et le mal-être au travail entraînant des coûts considérables pour les organisations, les employeurs ont donc intérêt à mettre en place des pratiques de reconnaissance suffisantes, inclusives et adaptées, qu’il s’agisse de rétroactions verbales, de consultations individuelles, d’autonomie dans les tâches ou encore d’accès à des occasions de développement professionnel.
Références
Université Laval : Cours psychologie de l’adulte au travail (Anne-Catherine Dubuc, conseillère d’orientation et chargée d’enseignement, 2024)
https://pharesst.irsst.qc.ca/rapports-scientifique/335/
Fall, A. (2014). « Justice organisationnelle, reconnaissance au travail et motivation intrinsèque : résultats d’une étude empirique ». Relations industrielles / Industrial Relations, 69(4), 709–731. https://doi.org/10.7202/1028109ar
Vézina, M., Cloutier, E., Stock, S., Lippel, K., Fortin, É., Delisle, A., . . . Audet, N. (2011). Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST) (Rapport n° R-691). INSPQ; ISQ; IRSST.
* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre