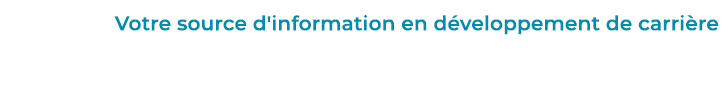|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Plusieurs tentatives d’intégrer l’orientation en milieu scolaire, que ce soit les cours d’éducation au choix de carrière, les projets personnels d’orientation (PPO), la compétence 054M ou le tremplin DEC n’auraient pas nécessairement atteint les résultats escomptés. Malgré la diversification et l’évolution des approches en orientation, un cadre pédagogique aurait pu bonifier l’accompagnement des jeunes. Un angle de cette pédagogie miserait sur la compétence à choisir (la pédagogie de la décision). Ce texte ne vise qu’à effleurer l’existence de cette approche pédagogique en orientation. Les intéressés pourront approfondir ce sujet à leur guise.
Que ce soit pour effectuer un simple achat en ligne, commander un mets ou pour adopter un mode de vie, les principes reposent sur des bases similaires comme celles convoquées à l’occasion d’un choix de carrière. Ces bases consistent à poser progressivement des questions de plus en plus complexes. Sans ce cadre, certaines conceptions biaisées, trop simplifiées, risquent de s’incruster en sabotant davantage le jugement décisionnel. Par exemple, penser qu’une profession se choisit quasi uniquement à partir de résultats psychométriques, qu’une carrière rime avec certitude ou que tout dépend uniquement de notre volonté pour réussir. Évident de constater que ces conceptions peuvent enliser un individu dans sa quête vocationnelle.
Par où doit-on engager une réflexion pour aider le questionneur à se sortir de cette vrille qui l’amène à reproduire les mêmes impasses surtout lorsqu’il cherche à renforcer ce qu’il souhaite croire? Initialement, c’est de révéler clairement nos intentions de l’aider à intégrer un regard critique sur ses propres conceptions. Aussi, c’est de lui rappeler continuellement le piège des biais cognitifs et la nécessité de les repérer soi-même.
Complémentaire au counseling de carrière, cette pédagogie offrirait un tremplin vers l’autonomie décisionnelle.
Ardue pour des gens présentant des dogmes, il importe d’ajuster la courbe d’apprentissage en échelonnant le degré de complexité des exercices.
Présenter progressivement une hiérarchisation de questions selon la complexité initierait la personne à garder en tête l’omniprésence d’angles morts. En repérant fréquemment ces angles morts, cette personne notera l’importance d’alimenter son questionnement continuellement. Par exemple, si elle s’intéresse à la rémunération d’un pilote d’avion, elle s’attendrait à trouver une réponse simple comme un salaire annuel. Décontextualisée, l’information salariale n’apporterait pas tant de valeur décisionnelle. Voici une série de questions évoluant en complexité pour mieux couvrir la notion salariale d’un pilote d’avion :
– À partir de quelles sources fiables pourrait-elle recueillir l’information salariale?
– Quelles seraient les différentes échelles salariales selon les catégories de pilotes?
Avec ces questions simples, elle remarquera qu’elle ne peut couvrir l’essentiel qu’avec une seule réponse. S’avouer qu’il ne suffit plus de connaître le salaire, il s’agirait d’une occasion d’enchaîner des questions de plus en plus contextualisantes comme :
– Combien d’expérience un pilote devra-t-il acquérir avant d’atteindre la rémunération moyenne?
Encore plus complexes, les questions devront considérer la valeur personnelle. Par exemple :
– Qu’est-ce qu’une rémunération satisfaisante?
– Quel train de vie cette personne espère-t-elle maintenir en fonction d’une rémunération souhaitée?
Avec cette évolution d’interrogations, il devient évident qu’il ne suffit pas juste de savoir, mais que ça nécessite un engagement plus approfondi à l’égard d’une quête d’information. De cette manière, l’aspirant pilote comprendra mieux nos intentions de l’accompagner vers un choix responsable et éclairé sans emprunter une approche argumentative. Bref, en répétant ce type d’exercice, la personne en réflexion sollicitera de plus en plus un regard critique sur ses propres méthodes décisionnelles tout en se rappelant de l’omniprésence d’angles morts.
Par exemple, les défis entrepreneuriaux sont souvent sous-estimés par l’aspirant entrepreneur tout en se surestimant à la fois parce qu’il ne se doute probablement pas de la complexité d’un tel projet. En ce sens, plusieurs facettes cachées de l’entreprenariat devront essentiellement être couvertes. Si nous abordions l’effort à engager et les risques encourus en entreprenariat, cette approche pourrait être interprétée comme une confrontation plutôt qu’un conseil. Progressivement, voici une série de questions suggérées dont les réponses sont de plus en plus complexes :
– Quel service/produit l’aspirant entrepreneur souhaite-t-il développer?
Ensuite :
– Combien d’années d’expérience et d’expertise seraient nécessaires à acquérir avant de se lancer?
– Quelles sont les étapes incontournables par lesquelles il doit passer pour s’assurer d’une prospérité dans son projet?
– En quoi le service/produit vient-il se démarquer dans un marché compétitif?
Toujours avec une logique progressive :
– De quelles stratégies pourrait-il se doter pour traverser les fluctuations économiques à long terme?
– Pendant combien de temps compte-t-il s’engager dans ce projet et à quels signaux devra-t-il être attentif pour admettre d’abdiquer?
Avec cette série de questions, l’aspirant entrepreneur s’apercevra de plusieurs aspects qui ne lui seraient pas venus à l’esprit. Il réalisera ainsi qu’il devra continuellement remettre en question ses perceptions malgré une impression de certitude. Même si les réponses demeurent floues, il pourra élargir son regard face à l’entreprenariat tout en progressant vers une autonomie décisionnelle.
Globalement, il s’agit de questionner notre façon de se questionner, de cultiver le doute que l’information recueillie peut être erronée et que les mauvaises décisions sont probables. Plusieurs modèles théoriques mettent en évidence ces aspects, dont la taxonomie de Bloom et la dissonance cognitive de Harmon-Jones et Mills. Même que plusieurs de ces modèles vulgarisés peuvent être présentés directement au cours d’interventions. Conscient de nos intentions, l’aspirant pourra mieux articuler ses réflexions vers un choix éclairé.
La pédagogie de la décision ne se limiterait pas qu’aux processus décisionnels. Elle s’adapte aussi aux habiletés relationnelles en sensibilisant le communicateur à comprendre l’impact de ses paroles et en l’aidant à accorder de l’importance aux réactions de son récepteur. Elle catalyserait la psychothérapie en favorisant un recul sur soi, en exerçant l’anticipation émotionnelle. Elle outillerait les personnes à pallier la procrastination en repérant les comportements annonciateurs d’ajournement. Même la sociopolitique l’intègre pour aider les citoyens à questionner leur position trop campée en identifiant mieux leurs valeurs pour reconsidérer leur allégeance politique. Loin d’être unique, la pédagogie de la décision se combine à d’autres approches développementales.
* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre.