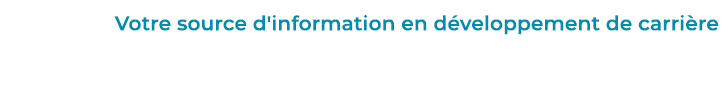|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Introduction
Au cours des dernières décennies, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) s’est imposé comme une réalité incontournable dans les milieux scolaires et professionnels. Défini par des symptômes persistants d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité nuisant au fonctionnement ou au développement de la personne (APA, 2022), le TDA/H touche aujourd’hui une part croissante de la population mondiale. Sa prévalence a connu une forte augmentation au cours des vingt dernières années, tant à l’échelle mondiale (de 5,3 % à 8,0 %) (Polanczyk et al., 2007 ; Ayano et al., 2023) qu’au Québec (de 0,8 % à 4,2 %) (INSPQ, 2024), reflet de l’amélioration des méthodes de dépistage et de la reconnaissance accrue du trouble.
Au-delà des chiffres, ces données rappellent que le TDA/H peut avoir des répercussions importantes sur la réussite scolaire, l’insertion professionnelle et la qualité de vie. Dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle, elles invitent à poser une question centrale : le TDA/H constitue-t-il un frein au choix vocationnel ? Afin d’alimenter cette réflexion, des personnes étudiantes inscrites au cours Intervention en milieu d’éducation de la maîtrise en sciences de l’orientation de l’Université Laval ont débattu de cette problématique en défendant un camp qui leur avait été assigné. Le présent article propose une synthèse de leurs arguments, enrichie par les connaissances scientifiques actuelles.
Le TDA/H : de quoi parle-t-on?
Le TDA/H est associé à des difficultés d’inattention, d’impulsivité et parfois d’hyperactivité. Si l’hyperactivité domine souvent dans l’enfance, à l’âge adulte, les difficultés concernent davantage la planification, la régulation émotionnelle, et l’organisation. Ces symptômes sont généralement liés à des dysfonctionnements dans les fonctions exécutives, qui influencent des compétences essentielles à la décision vocationnelle : anticiper, évaluer plusieurs options, gérer les délais, tolérer l’incertitude (Barkley, 2010 ; Becker, 2020).
Camp « Oui, le TDA/H entrave le choix vocationnel »
Les jeunes vivant avec un TDA/H présentent divers symptômes, dont l’impulsivité, qui peuvent persister à l’âge adulte et influencer leurs choix personnels et professionnels (Vincent, 2007). Attirés par de nouvelles idées, ils éprouvent des difficultés à s’engager sur le long terme, ce qui fragilise leur stabilité décisionnelle et leur capacité à se projeter dans l’avenir, une compétence clé pour élaborer un projet vocationnel durable. Le TDA/H affecte également les fonctions exécutives — organisation, inhibition, planification, mémoire de travail — en lien avec un retard de maturation de certaines zones cérébrales (Parent et al., 2019 ; Bélanger et al., 2018). Barkley (2022) insiste sur le fait que les déficits d’autorégulation, au cœur du TDA/H, expliquent l’ampleur des difficultés fonctionnelles observées au-delà des seuls symptômes d’inattention ou d’hyperactivité.
À l’école, bien que leur quotient intellectuel soit comparable à celui de leurs pairs (Massé et al., 2019), ces jeunes rencontrent des défis liés à l’attention, à l’organisation et au respect des consignes (Duchaine & Gaudreau, 2021), ce qui peut limiter leur réussite, restreindre leurs aspirations et entraver leur accès aux études postsecondaires. Ces obstacles scolaires, combinés aux difficultés exécutives (Schepman et al., 2012) et à des comorbidités fréquentes comme l’anxiété ou la faible estime de soi (Tomevi, 2013), compliquent la construction d’un projet vocationnel stable. Ils peuvent également favoriser l’évitement décisionnel, l’instabilité de parcours et accroître les croyances vocationnelles dysfonctionnelles (Norwalk et al., 2009 ; Painter et al., 2008). Enfin, la rigidité du milieu scolaire et la stigmatisation sociale exacerbent ces défis (Hotte-Meunier et al., 2024).
Camp « Non, il n’entrave pas nécessairement »
Le diagnostic de TDA/H n’entrave pas nécessairement le développement d’un projet vocationnel épanouissant. Les jeunes concernés disposent d’un véritable pouvoir d’agir face à leur situation.
Avec le temps, ils apprennent à mieux comprendre comment leur TDA/H se manifeste et à mettre en place des stratégies d’adaptation.
Dans ce processus, la connaissance de soi joue un rôle clé, en leur permettant d’identifier leurs besoins spécifiques et de mobiliser des moyens efficaces pour y répondre. Les personnes conseillères d’orientation peuvent soutenir ce cheminement en amenant les jeunes à réfléchir à leurs expériences du trouble (Dipeolu, 2011).
Adoptant une approche centrée sur les forces, Lachenmeier (2023) propose de remplacer le terme « TDA/H » par « UMIF » (Unusual Management of Information and Functions), soulignant ainsi que ces jeunes possèdent des modes de traitement de l’information différents plutôt que déficitaires. Certains traits comme l’hyperfocalisation ou la réactivité en situation d’urgence peuvent devenir de précieux atouts dans certains contextes professionnels. Cette perspective rejoint l’idée que de nombreux jeunes vivant avec un TDA/H se sentent mieux préparés à prendre des décisions vocationnelles (Perron et al., 2024), même si leur impulsivité peut parfois conduire à des choix précipités (Tomevi, 2013 ; Schepman et al., 2012).
Leur enthousiasme naturel, particulièrement lorsqu’ils sont passionnés par un domaine, favorise également leur persévérance scolaire. Valoriser ces forces individuelles leur permet de faire des choix alignés avec leurs aspirations. Plusieurs milieux de travail commencent d’ailleurs à reconnaître l’intérêt d’ajuster les environnements pour mieux soutenir la réussite des personnes neurodivergentes (Hotte-Meunier et al., 2024).
Conclusion : vers une orientation inclusive
Les transitions développementales influencent fortement la manifestation des symptômes du TDA/H et, par ricochet, la qualité de la prise de décision. À l’adolescence et au début de l’âge adulte, alors que les exigences décisionnelles augmentent, les capacités exécutives peuvent rester immatures, rendant les périodes de transition scolaire et professionnelle particulièrement critiques (Shaw & Sudre, 2021). Ces constats soulignent l’importance d’un accompagnement différencié.
Par ailleurs, les outils traditionnels d’évaluation de l’indécision vocationnelle tendent à négliger des dimensions essentielles telles que l’auto-régulation, la surcharge cognitive et la fatigue décisionnelle. Des approches qualitatives, basées sur l’observation contextuelle et une temporalité d’exploration flexible, sont nécessaires pour mieux répondre aux réalités des jeunes concernés.
Le débat sur l’influence du TDA/H rappelle qu’il est réducteur d’associer ce trouble à une destinée d’échec. Si le TDA/H peut complexifier la prise de décision, il ne détermine pas à lui seul les trajectoires vocationnelles. L’enjeu n’est pas d’adapter la personne au système, mais de rendre les systèmes plus accueillants à la diversité cognitive.
Bien que la recherche sur le TDA/H ait longtemps été dominée par un modèle biomédical, plusieurs auteurs (Barkley, 2022 ; Cortese et al., 2022) plaident pour une approche intégrative, tenant compte des facteurs psychosociaux et de la neurodiversité.
Une orientation inclusive, en reconnaissant à la fois les besoins particuliers et les forces des profils atypiques, permet aux jeunes de tracer des parcours uniques et de retrouver un véritable pouvoir d’agir sur leur avenir professionnel.
Recommandations pour les personnes intervenantes
Pour mieux accompagner les jeunes vivant avec un TDA/H dans leur parcours scolaire, professionnel et personnel, plusieurs principes doivent orienter les pratiques.
Il est essentiel d’intégrer systématiquement le dépistage du TDA/H dans les démarches d’orientation, en évaluant à la fois les symptômes et leurs impacts sur le fonctionnement global, notamment en lien avec les fonctions exécutives (organisation, gestion du temps, autorégulation émotionnelle).
Les interventions doivent adopter une approche développementale, en reconnaissant le TDA/H comme un trouble persistant de l’autorégulation qui évolue avec l’âge, et non comme un simple déficit attentionnel.
Il importe aussi de valoriser les forces associées au TDA/H — enthousiasme, créativité, rapidité d’action sous stress — en reconnaissant une gestion différente de l’information (Lachenmeier, 2023) et en favorisant des parcours éducatifs et professionnels non conventionnels, adaptés à ces profils.
La formation des personnes intervenantes aux réalités neurodivergentes est indispensable pour assurer un accompagnement nuancé et respectueux de la diversité des fonctionnements.
Enfin, il est crucial de créer des environnements d’apprentissage et de travail inclusifs et flexibles, soutenant l’autorégulation, la réussite et l’autonomie de chaque personne.
Dans cette perspective, l’accompagnement des personnes vivant avec un TDA/H doit s’inscrire dans un processus continu, visant à soutenir leur fonctionnement global à toutes les étapes de leur développement.
* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre
Références
American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787
Ayano, G., Tsegay, L., Gizachew, Y., Necho, M., Yohannes, K., Abraha, M., Demelash, S., Anbesaw, T., & Alati, R. (2023). The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses. Journal of Affective Disorders, 328, 115449. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.115449
Barkley, R. A. (2010). Deficient emotional self-regulation: A core component of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of ADHD and Related Disorders, 1(1), 5–37.
Barkley, R. A. (2022). Treating ADHD in children and adolescents: What every clinician needs to know. Guilford Publications.
Becker, S. P. (2020). ADHD and future-oriented thinking: Introduction to the special issue. Journal of Attention Disorders, 24(14), 1939–1942. https://doi.org/10.1177/1087054720940196
Bélanger, S. A., Andrews, D., Gray, C., & Korczak, D. (2018). Le TDAH chez les enfants et les adolescents, partie 1 : l’étiologie, le diagnostic et la comorbidité. Paediatrics & Child Health, 23(7), 454–461. https://doi.org/10.1093/pch/pxy110
Cortese, S., Sabé, M., Chen, C., Perroud, N., & Solmi, M. (2022). Half a century of research on attention-deficit/hyperactivity disorder: A scientometric study. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 140, 104769. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104769
Dipeolu, A. O. (2011). College students with ADHD: Prescriptive concepts for best practices in career development. Journal of Career Development, 38(5), 408–427. https://doi.org/10.1177/0894845310378749
Duchaine, M.-P., & Gaudreau, N. (2021). TDAH et formation du personnel enseignant : Les effets perçus d’un MOOC. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 11(2), 31–38.
Hotte-Meunier, A., Sarraf, L., Bougeard, A., Bernier, F., Voyer, C., Deng, J., El Asmar, S., Stamate, A. N., Corbière, M., Villotti, P., & Sauvé, G. (2024). Strengths and challenges to embrace attention-deficit/hyperactivity disorder in employment: A systematic review. Neurodiversity, 2, 1–13. https://doi.org/10.1177/27546330241287655
Institut national de santé publique du Québec. (2024, 3 décembre). Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) – Prévalence, incidence et distribution régionale au Québec [Présentation PowerPoint]. Journées annuelles de santé publique (JASP), Montréal.
Lachenmeier, H. (2023). ADHD and success at work: How to turn supposed shortcomings into strengths. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13437-1
Massé, L., Verret, C., Nadeau, M.-F., & Lagacé-Leblanc, J. (2019). Quelles stratégies peuvent être adoptées par les parents pour favoriser la réussite scolaire de leur enfant ayant un TDAH? La Foucade – Numéro spécial sur le TDAH, 19(2), 87–90.
Norwalk, K. E., Norvilitis, J. M., & MacLean, M. G. (2009). ADHD and self-efficacy: The impact of academic self-efficacy and self-efficacy for self-regulation on academic functioning. Journal of Attention Disorders, 13(5), 493–502. https://doi.org/10.1177/1087054708320404
Parent, V., Vaudeville, I., & Psy, D. (2019). Rendement scolaire et fonctionnement exécutif chez les jeunes ayant un TDA/H : Le contexte de la transition primaire-secondaire. Neuropsychologie Clinique et Appliquée, 3(1). https://doi.org/10.46278/nca.v3i1.10
Painter, K. R., Prevatt, F., & Welles, T. (2008). Career beliefs and job satisfaction in adults with symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Attention Disorders, 11(5), 693–701. https://doi.org/10.1177/1087054707311873
Perron, J.-F., Guay, F., & Masson, S. (2024). Indécision vocationnelle à l’adolescence : Analyse d’un modèle explicatif intégrant les fonctions exécutives [Thèse de doctorat, Université Laval]. Corpus UL.
Polanczyk, G., de Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. American Journal of Psychiatry, 164(6), 942–948. https://doi.org/10.1176/ajp.2007.164.6.942
Schepman, J., Weyandt, L. L., Schlect, S. D., & Swentosky, A. (2012). The relationship between ADHD symptomology and decision making. Journal of Attention Disorders, 16(1), 3–12. https://doi.org/10.1177/1087054710372496
Shaw, P., & Sudre, G. (2021). Adolescent brain development: Implications for understanding risk and resilience processes through neuroimaging research. Developmental Cognitive Neuroscience, 48, 100924. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2021.100924
Tomevi, C. (2013). Career-decision self-efficacy among college students with symptoms of attention deficit disorder. McNair Scholars Research Journal, 9(1), Article 11.
Vincent, A. (2007). Mon cerveau a encore besoin de lunettes : Le TDAH chez l’adulte. Québecor.
Les personnes étudiantes inscrites au cours Intervention en milieu d’éducation de la maîtrise en sciences de l’orientation de l’Université Laval ont débattu de certaines problématiques en défendant un camp qui leur avait été assigné. Lydia Lefebvre, Gabriel Marcoux, Sophie McInnes et Claudia Robichaud-Pelletier sont des étudiants de ce programme, profil Intervention, et ont rédigé, en collaboration avec leur professeur, Jean-François Perron, un article synthèse issu de leurs recherches et de leur expérience en situation de débat.
Les personnes étudiantes inscrites au cours Intervention en milieu d’éducation de la maîtrise en sciences de l’orientation de l’Université Laval ont débattu de certaines problématiques en défendant un camp qui leur avait été assigné. Lydia Lefebvre, Gabriel Marcoux, Sophie McInnes et Claudia Robichaud-Pelletier sont des étudiants de ce programme, profil Intervention, et ont rédigé, en collaboration avec leur professeur, Jean-François Perron, un article synthèse issu de leurs recherches et de leur expérience en situation de débat.