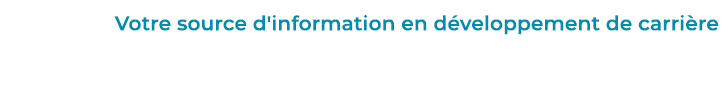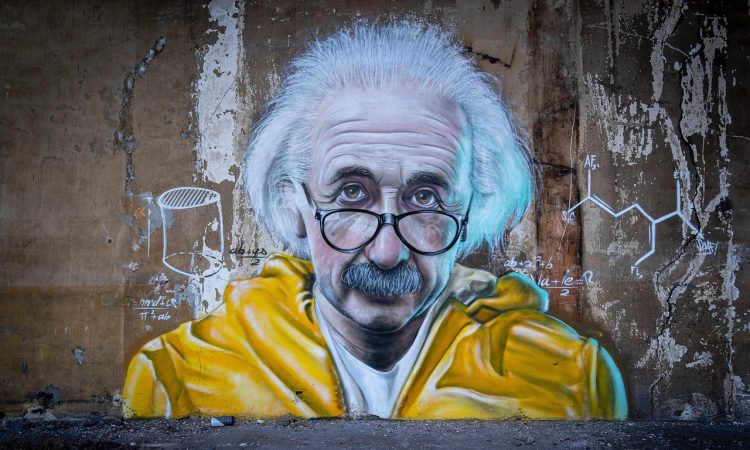
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Depuis le 19e siècle, scientisme (nom) et scientiste (adjectif) sont les mots utilisés pour décrire une attitude philosophique ou une doctrine qui considère la science comme la seule source de connaissance fiable et la seule voie ou méthode valide pour résoudre l’entièreté des problèmes, quel que soit leur ampleur. S’inspirant de ce qui est déjà écrit, l’IA associe à cette attitude ou doctrine quatre caractéristiques : la suprématie de la science, la généralisation de la méthode scientifique, l’optimisme excessif quant au pouvoir de la science et le réductionnisme.
Toutes les autres formes d’acquisition de savoir (philosophique, spirituelle, artistique, etc.) – dont les humanités – sont alors disqualifiées et les autres (anthropologie, psychologie, sociologie, etc.) seront progressivement qualifiées de « sciences molles »! Il en va de même également des champs de recherche et de pratique à fondement multiple comme la pédagogie, l’orientation et la carriérologie. Du coup, en dépit de la complexité des problèmes du monde, de la société et des personnes, le réductionnisme triomphe. Aucune place, par exemple, pour les questions d’empathie, d’éthique ou de morale.
Il s’ensuit, y compris dans la population en général, une confiance incommensurable en la science, et si celle-ci ne trouve pas promptement une réponse ou une solution probante ou encore si elle ne parvient pas à un consensus entre les experts, comme ce fut le cas lors du diagnostic et du traitement de la Covid, alors la science risque d’être globalement écartée, sans nuance aucune laissant libre cours aux thèses conspirationnistes les plus farfelues. La science devient alors le bébé jeté avec l’eau du bain!
Version 21e siècle
Scientisme et scientiste font toujours référence à un excès presque éhonté de la science1, mais particulièrement en ce premier quart du 21e siècle, à un intérêt secondaire, voire à une mise au rancard de toutes les questions pratiques et d’applications de la vie courante.
C’est la suprématie de la science, la science pour la science!
Or, de nos jours, plus que jamais dans le monde scientifique, le leitmotiv étant « publish or perish »2, il appert que tout ce qui se publie est largement façonné, souvent inconsciemment, par ce scientisme et ses dérives : revue circonscrite de la littérature scientifique, par exemple, aux dix dernières années, échantillonnage peu représentatif (non aléatoire, etc.,) des populations concernées, pas ou peu de souci de rejoindre une masse critique de gens ou un problème majeur (résultats non généralisables), pas ou peu d’intérêt pour les applications concrètes, praticiens exclus des comités scientifiques des revues et congrès, car n’étant pas considérés comme des pairs 3, etc.
Quelques conséquences
Retranchés dans leur tour d’ivoire, les « scientistes » côtoient un monde fort restreint utilisant un discours quelque peu herméneutique, donc inaccessible à la majorité des non-initiés. Pas étonnant, alors, que les publications de ceux-là ne soient consultées que par une poignée de lecteurs, dont leurs propres « disciples ».
Elles demeurent donc lettres mortes.
Majoritaire à cause de ce qui vient d’être écrit plus haut, la population qui pour une bonne part subventionne ces recherches et chercheurs – ignore ou se désintéresse de ces contributions, d’où son indifférence quand ces instances (chercheurs, centres de recherche) cessent d’être subventionnées.
La vulgarisation de ces données est le plus souvent reléguée à des journalistes et chroniqueurs généralistes se plagiant les uns les autres allègrement. Ainsi, durant une crise, on a spontanément d’abord recours à l’opinion d’un vox populi composé de quelques individus plutôt qu’à celle d’un expert du domaine.
Faut-il alors s’étonner que dans un tel contexte qualifié de post-scientifique, un populiste comme Donald Trump a beau jeu et peut sans gêne et sans tollé saborder des recherches importantes et des chercheurs rigoureux, risquant ainsi de plonger le monde dans une ère d’obscurantisme?
Références
1. Comme dans carriériste, jovialiste (au Québec) ou islamiste, le suffixe « -iste » indiquant cet excès.
2. C’est-à-dire, aucune permanence ou promotion sans un certain nombre de publications dans des revues élitistes ciblées.
3. N’est ici pair qu’un autre chercheur ayant un diplôme, un poste ou un champ de recherche similaire.
* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre