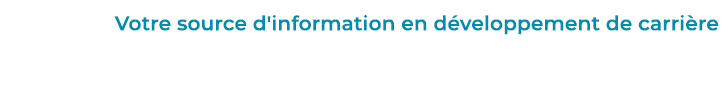|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Le travail autrefois… synonyme de souffrances et sacrifices
On a longtemps pensé que le mot « travail » était dérivé du latin tripalium, qui était en fait un instrument de torture, évoquant ainsi la douleur et la souffrance alors souvent associée au travail. Le mot travail viendrait plutôt de « travail », une sorte d’appareil en bois accroché en arrière du cheval. Il n’en reste pas moins que le travail a longtemps été associé au sacrifice, au dur labeur.
Au Moyen Âge, travailler signifiait peiner ou endurer, et l’activité laborieuse était perçue comme un moyen de rachat du péché originel. Longtemps, le terme « travailler » était décrit dans les dictionnaires comme une activité marquée pénible et souffrante. Avec le temps, le terme a évolué pour désigner plus largement une activité humaine, physique ou intellectuelle, aujourd’hui exercée contre rémunération.
Néanmoins, certaines croyances populaires persistent.
Des expressions comme « travailler pour gagner son ciel » ou « gagner sa vie » traduisent une vision encore imprégnée de l’idée de sacrifice, héritée de l’influence du christianisme.
Le travail, comme moyen de subsistance
Pendant des siècles, le travail a été avant tout une nécessité économique servant à subvenir aux besoins essentiels des familles. Travailler était donc une obligation souvent associée à une connotation négative. De plus, le travail agricole et manuel, était réservé aux classes de la société que l’on disait « inférieures ». Les classes supérieures, quant à elles, pouvaient s’adonner à des activités libres, de nature politique et de loisirs. Cette division sociale renforçait l’idée selon laquelle ne pas avoir à travailler était un privilège ou un signe de réussite ou de noblesse.
Le travail, une norme sociale bien ancrée
Même si aujourd’hui le travail ne sert plus uniquement qu’à répondre aux besoins de base des individus, il demeure néanmoins une norme sociale. Les personnes qui ne travaillent pas sont souvent perçues comme marginales aux yeux de la société. Le travail conserve ainsi une grande valeur symbolique (réussite, contribution sociale, etc.) et joue un rôle central dans l’organisation de la vie collective.
Les finalités du travail : pourquoi travaille-t-on aujourd’hui?
Le travail permet de subvenir à ses besoins et de se procurer des biens de consommation. Aujourd’hui toutefois, il ne s’agit plus seulement de satisfaire les besoins essentiels, mais également de pouvoir accéder à davantage de matériel, souvent signe d’accomplissement personnel, de réussite. Le travail constitue donc un moyen d’obtenir un statut social, pouvant conférer une certaine forme de prestige.
Travailler aide également à structurer le temps et l’espace et éviter de tomber dans le désœuvrement avec les enjeux que cela peut comporter : difficultés financières, risques d’isolement social, dépendances, etc. C’est également un lieu d’échanges sociaux. Le travail offre en effet l’opportunité de rencontrer des gens et de créer des liens avec sa communauté. Finalement, travailler permet de se sentir utile, en apportant sa contribution à la société. Le rapport au travail peut varier d’une personne à l’autre et évoluer au fil du parcours professionnel, en fonction des événements de vie et des transformations sociales. Néanmoins, les recherches démontrent que le revenu demeure, de façon générale, la principale raison pour laquelle les individus occupent un emploi.
L’émergence d’une quête de sens
Bien que la finalité principale du travail soit le revenu, les travailleurs d’aujourd’hui ne s’en contentent pas : ils aspirent désormais à occuper un emploi porteur de sens, en résonance avec leurs valeurs et leur identité. Le travail devient également un lieu de construction identitaire en soi. On constate également une montée des aspirations personnelles chez les travailleurs d’aujourd’hui : désir de réalisation de soi, engagement dans des projets et des tâches porteuses de sens, recherche d’un meilleur équilibre de vie, volonté d’apprentissage et de développement personnel, entre autres. Parallèlement, les finalités collectives et sociales comme travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ou contribuer à sa communauté tendent à s’effacer, au profit de trajectoires plus individualisées.
Références
Da Silva, A. (1995). « La conception du travail dans la Bible et dans la tradition chrétienne occidentale ». Théologiques, 3(2), 89–104. https://doi.org/10.7202/602426ar
Avoine, J., Giguère, E. (2024). Cours Travail humain : Évolution historique du travail humain [présentation PowerPoint]. Université Laval. http://www.ulaval.ca
Lahrizi, I., (2024). Cours Choix de carrière: Module 3 (rapport au travail) [présentation PowerPoint]. Université Laval. http://www.ulaval.ca
* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre